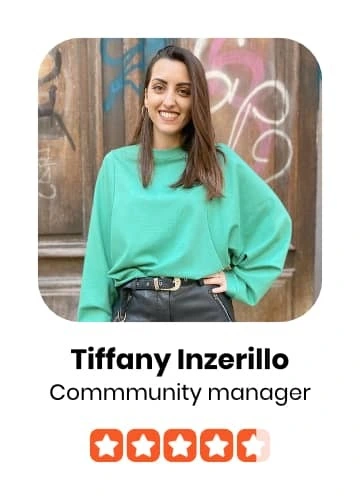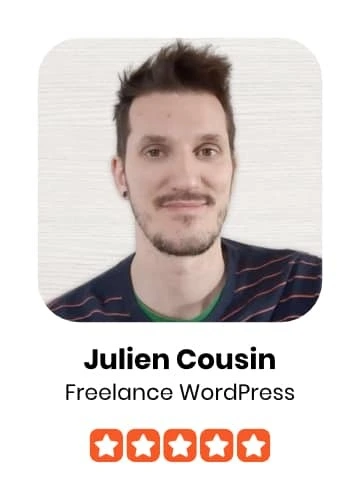Le portage salarial est un statut hybride qui combine les avantages de l’entrepreneur et du salarié. Ce système permet à un freelance de conserver son indépendance tout en bénéficiant de la protection sociale et de l’assurance chômage. En tant que salarié porté, vous trouvez vos propres missions, mais vous les réalisez dans le cadre d’un contrat de travail avec une société de portage. Ce modèle repose sur une relation tripartite entre le salarié porté, la société de portage et le client. Découvrez ce que doit mentionner chaque contrat pour sécuriser cette organisation.
La relation tripartite du portage salarial
Le portage salarial engage trois parties : le salarié porté, le client et la société de portage. Chaque partie a des obligations, décrites dans les trois contrats les liant les unes aux autres.

Le portage salarial, comment ça marche ?
Le freelance qui a fait le choix du portage salarial a un statut hybride : il est à la fois entrepreneur indépendant et salarié de la société de portage.
En tant qu’indépendant, le salarié porté conserve l’entière responsabilité et liberté de choisir ses clients. L’entreprise de portage n’est pas tenue de lui fournir du travail. C’est à lui de trouver ses missions. Il négocie ses tarifs en direct avec ses clients, ainsi que les modalités d’exécution des prestations.
En tant que salarié, il perçoit un salaire et bénéficie des avantages sociaux des salariés. Concrètement, son salaire correspond au prix des prestations réalisées pour ses clients, après déduction des charges sociales, salariales, patronales et des frais de gestion.
La rémunération varie en fonction des missions réalisées. La société de portage n’a aucune obligation de verser un salaire à son salarié porté s’il n’a pas de client. Il est alors en intermission.
Comment adhérer à une société de portage salarial ?
Un indépendant peut adhérer à tout moment à un dispositif de portage, même s’il n’a pas de mission en vue. Il peut choisir ce statut au lancement de son entreprise ou après plusieurs années d’activité. Une seule condition est obligatoire : exercer une prestation de services intellectuelle non réglementée.
La première étape pour accéder au statut de salarié porté consiste à contractualiser avec une société de portage via une convention d’adhésion. Celle-ci définit les modalités du portage et les engagements mutuels du salarié porté et de l’entreprise de portage.
Ce document doit être lu attentivement. Il indique notamment les frais de gestion appliqués par la société de portage sur chaque mission réalisée par le salarié porté. Il précise également la durée de l’engagement et les conditions de versement du salaire et de remboursement des frais professionnels.
C’est également dans la convention d’adhésion que sont détaillés les avantages sociaux du salarié porté (congés payés, assurance responsabilité civile professionnelle, caisses de retraite, prévoyance, convention collective).
Le contrat de mission avec le client
Une fois la société de portage choisie, le freelance doit trouver une première mission. Le contrat de mission ou de prestation régit chaque projet entrepris. Bien que la société de portage soit officiellement l’interlocuteur contractuel avec le client, c’est le salarié porté qui négocie les modalités de la mission, y compris le tarif et les conditions d’exécution.
Si la société de portage est identifiée comme le prestataire de services, c’est bien le salarié qui doit trouver ses clients en portage salarial.
Le contrat de mission doit inclure des informations essentielles, telles que :
- Les coordonnées du client.
- Les détails de la mission (description, lieux, horaires, matériel).
- Le tarif et la durée de la prestation.
- Les conditions de règlement (par exemple, un acompte ou un paiement à la fin de la mission).
- Les clauses particulières (confidentialité, propriété intellectuelle…).
- L’assurance responsabilité civile professionnelle du freelance.
Généralement, la société de portage fournit un contrat type pour sécuriser la prestation.
Le contrat de travail avec la société de portage
Un contrat de travail est signé entre la société de portage et le freelance dès que celui-ci a trouvé sa première mission.
Quelles différences entre un contrat de travail en portage salarial et un contrat classique ?
Le contrat de travail en portage salarial se distingue du contrat de travail classique par de nombreuses mentions particulières. Ainsi, il doit préciser :
- Les compétences du salarié porté et la nature de ses activités. Ses missions doivent obligatoirement s’inscrire dans son champ de compétences.
- La base de calcul du temps de travail du salarié dans le cadre de ses prestations en portage.
- Le mode de calcul de sa rémunération mensuelle. Contrairement au contrat de travail classique, le contrat en portage salarial n’indique pas de salaire précis (sauf s’il est signé dans le cadre d’une mission ponctuelle unique).
- Les obligations de reporting du salarié porté. S’il détermine librement ses horaires et ses moyens de travail, il doit rendre compte chaque mois à l’entreprise de portage de l’état d’avancement de ses missions et de ses prospections.
- Les modalités en cas d’absence ou d’impossibilité de réaliser une mission validée.
En dehors de ces mentions spécifiques, un contrat de portage salarial fonctionne sur les mêmes principes qu’un contrat de travail classique. Le salarié porté doit effectuer une période d’essai et se soumettre à une visite médicale. Il bénéficie aussi de congés payés à raison de 2,5 jours par mois.
CDD ou CDI en portage salarial ?
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée. Cela doit être indiqué précisément dans son intitulé.
Les différences entre le CDD et le CDI ?
- Le CDD a une durée maximum de 18 mois. Un CDD peut être renouvelé deux fois, dans la limite de cette durée. Il peut néanmoins être prolongé jusqu’à 21 mois pour faciliter la recherche de nouveaux clients après une mission longue. Mais si la société de portage et le salarié porté souhaitent poursuivre leur collaboration passé ce délai, un CDI doit être signé.
- Comme pour un contrat de travail classique, le CDD prend fin tacitement à l’issue de la période fixée dans le contrat de travail. La résiliation du CDI doit être motivée. Elle prend la forme d’une rupture conventionnelle, d’un licenciement ou d’une démission et peut ouvrir droit à des indemnités.
Bon à savoir : une mission ne peut excéder 36 mois. Au-delà de cette limite, elle peut être requalifiée en CDI au sein de l’entreprise cliente. Il est aussi possible de rompre un contrat de portage salarial.
Le choix entre CDI et CDD dépend de plusieurs facteurs. Le premier ? La durée et la régularité des missions. Un entrepreneur indépendant avec des missions ponctuelles et irrégulières peut préférer le CDD pour éviter les intermissions non rémunérées.
Mais il peut aussi opter pour un CDI pour des raisons extérieures à son activité professionnelle, par exemple pour faciliter l’accès à un logement ou à un prêt bancaire. Si la mission excède 18 mois, pas de choix possible, ce sera le CDI.
N’hésitez pas à opter pour un CDI. Il est toujours possible de changer pour une autre société de portage salarial, même en cours de contrat avec un client.
Notre astuce pour signer un contrat en portage salarial
Vous êtes convaincu par le portage salarial ? La première étape : signer une convention d’adhésion avec une société de portage. N’hésitez pas à comparer les offres, notamment les engagements mutuels, avantages sociaux et frais de gestion.
Pour conclure un contrat en portage salarial, vous devrez trouver une première mission. La plateforme Codeur.com propose des pistes concrètes pour devenir freelance et développer votre clientèle en remportant des missions. La plateforme propose avant tout des missions à court terme, mais certaines débouchent parfois sur des contrats à plus long terme.
À vous de jouer pour négocier vos contrats de prestation et… exécuter vos missions en toute sécurité, encadrées par la société de portage !